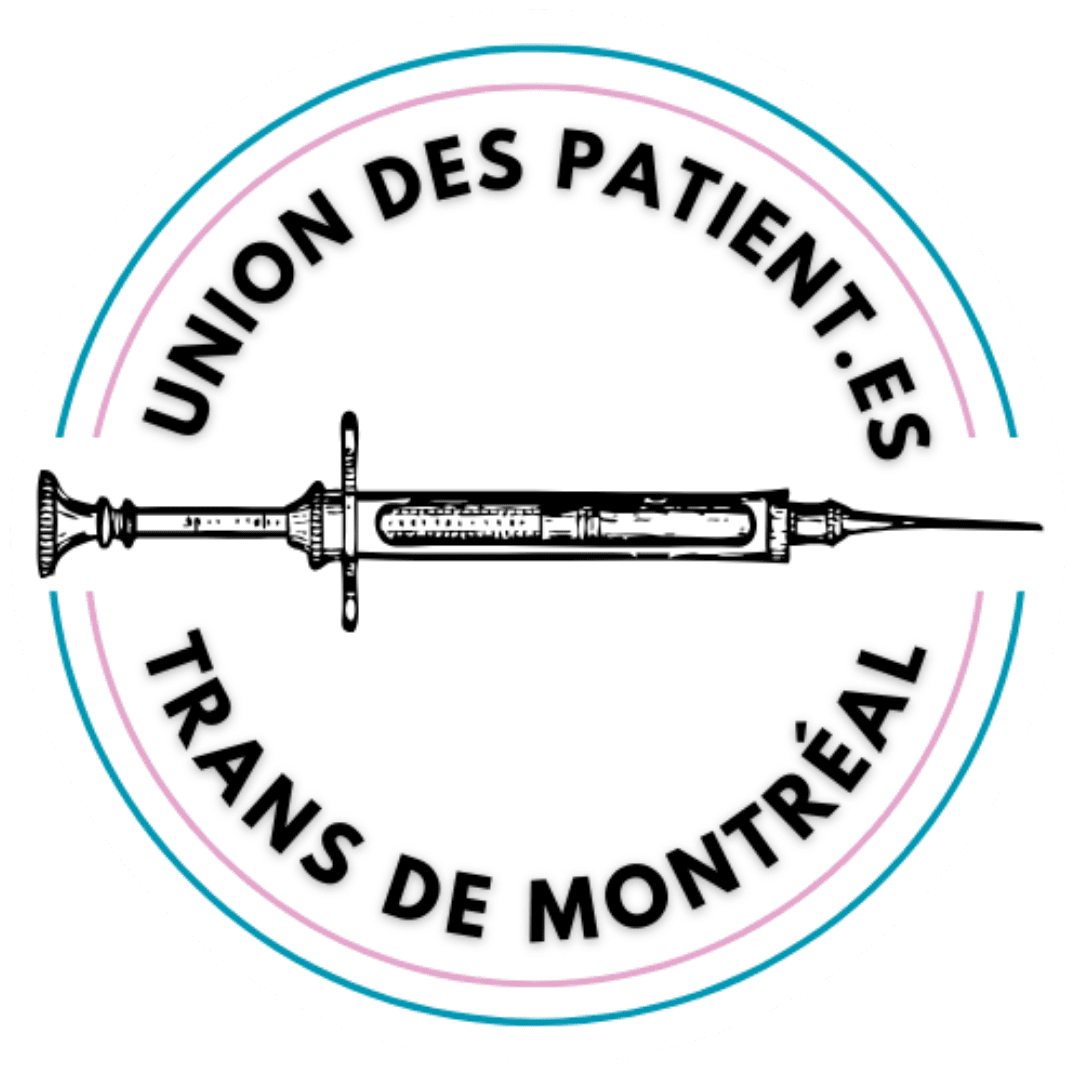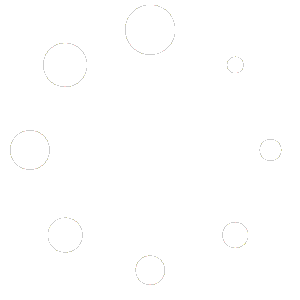Reconnaissance territoriale
En tant qu'organisation majoritairement composée de colons et de non-Autochtones, l'existence de l'Union des patient·e·s trans sur ce territoire dépend de l'exploitation coloniale. Nous opérons à Tio'tià:ke (également connue sous le nom de Montréal), le territoire et les eaux de la nation Kanien'kehá:ka. La terre nous offre ses richesses naturelles pour nous nourrir en tant que peuple, nous permettant ainsi de vivre et de travailler. Le régime colonial canadien empêche fondamentalement l'établissement de relations saines avec les terres et les cours d'eau de Tio'tià:ke. Cela se poursuit à travers l'histoire de la violence coloniale du Québec à l'égard du peuple Kanienʼkehá et l'exploitation des ressources naturelles des Haudenosaunee. En tant qu'organisation, nous nous sommes donné pour mission de décoloniser nos pratiques et de reconstruire notre relation avec cette terre et ses peuples autochtones. L'UPT est solidaire des Kanien'kehá:ka Kahnistensera (Mères Mohawks) et de leurs efforts continus pour obtenir justice sur le site funéraire de l'hôpital Royal Victoria.
En tant qu'organisation pour les personnes non conformes au genre, nous reconnaissons et respectons les communautés Two-Spirit et Indigiqueer à Tio'tià:ke. Two-Spirit est un terme générique désignant les identités autochtones de genre divers, inventé en 1990 lors de la troisième conférence annuelle intertribale des Amérindiens, des Premières Nations et des gays et lesbiennes américains à Winnipeg. En tant que colons, il est important de reconnaître que les identités Two-Spirit et Indigiqueer ne peuvent être confinées par les concepts coloniaux de genre. Le terme « Two-Spirit » n'est pas universel pour tous les peuples autochtones de l'île de la Tortue (connue sous le nom colonial d'Amérique du Nord), car différentes cultures ont leurs propres traditions et pratiques. De même, « Two-Spirit » n'est pas un terme universellement accepté et certaines personnes préfèrent utiliser d'autres termes. À Tio'tià:ke, Onón:wat est un terme kanienʼkehá:ka qui signifie « j'ai deux esprits dans mon corps ».
En tant que groupe de défense des soins de santé, nous honorons les pratiques traditionnelles des Kanien’kehá:ka, dont les connaissances liées à la terre, les médecines holistiques et les soins préventifs ont une longue histoire à Tio’tià:ke. L'exploitation coloniale et le génocide ont perturbé les traditions orales et la culture, y compris la médecine Kanien'kehá:ka. Les prestataires de soins de santé, les pensionnats et la police coloniale ont tenté d'éradiquer les connaissances et les soins médicaux autochtones. En fin de compte, le système médical canadien ne répond généralement pas aux besoins des peuples autochtones de Tio'tià:ke et au-delà. Les membres des Premières Nations sont deux à cinq fois plus susceptibles d'être victimes d'une forme de discrimination, notamment en raison de leur origine ethnique, leur culture, leur race, leur religion, leur apparence physique, leur orientation sexuelle, leur sexe, leur âge et/ou leur handicap physique ou mental. . La colonisation a largement perturbé les moyens dont disposaient les peuples autochtones pour prendre soin d'eux-mêmes, ce qui a eu des conséquences néfastes sur leur santé. Cela se traduit notamment par des taux plus élevés de maladies chroniques chez les peuples autochtones. Environ deux fois plus de membres des Premières Nations, de Métis et d'Inuits se sont identifiés comme handicapés que les personnes non autochtones. . De plus, en moyenne, la durée de vie d'une personne autochtone est estimée être plus courte de quatorze ans.
En plus des efforts coloniaux visant à imposer la binarité des genres, les personnes bispirituelles et indigiqueer sont confrontées à des défis uniques en matière de soins de santé. Ceux-ci peuvent résulter de l'intersectionnalité de la transphobie, de l'homophobie et du racisme, ainsi que d'autres facteurs tels que le classisme ou le capacitisme. En tant qu'organisation, nous sommes pleinement conscients des lacunes des espaces queer blancs dans la prise en compte des besoins des personnes bispirituelles et indigiqueer, et nous nous engageons à remédier à cette disparité.
En tant qu'Union des patient.e.s trans, nous visons à améliorer les conditions d'accès aux soins affirmant le genre pour tous.tes les patient.e.s. Cet objectif est impossible à atteindre sans une compréhension pratique de la manière dont le colonialisme continue de persécuter les personnes bispirituelles et indigiqueer dans le domaine des soins de santé. À l'heure actuelle, nous ne comptons aucun membre autochtone parmi nos membres. À partir de 2024, nous nous efforcerons d'élargir nos données d'entretiens et d'enquêtes afin d'inclure davantage d'expériences autochtones. Une fois ces données collectées, nous commencerons à élaborer des ressources traitant directement des obstacles spécifiques auxquels sont confrontées les personnes bispirituelles et indigiqueer dans leur parcours de santé. Nous souhaitons collaborer avec des organisations autochtones afin de créer des ressources destinées à soutenir les personnes bispirituelles, indigiqueer et onón:wat.
En conclusion, cette reconnaissance territoriale est un document de travail. Notre intention n'est pas de faire un geste symbolique, mais plutôt d'amorcer une réflexion continue et de nous engager envers les peuples, les terres et tous les êtres vivants de Tio'tià:ke.
Organisations autochtones à Montréal :
Kanien’kehá:ka Kahnistensera (Mères Mohawks)
Les Kanien’kehá:ka Kahnistensera sont une initiative qui s'engage à mettre au jour des preuves potentielles non découvertes et des tombes anonymes sur le site de l'ancien hôpital Royal Victoria. Les Mères Mohawks ont engagé une action en justice contre l'hôpital Royal Victoria afin de suspendre toute future excavation jusqu'à ce qu'une enquête archéologique appropriée soit menée.
Cercle Indigiqueer de Québec
Le Cercle Indigiqueer du Québec est un organisme qui défend le bien-être et les droits des personnes 2SLGBGTQIA+ de Tio’tià:ke et de l’ensemble des territoires québécois.
Foyer pour femmes Autochtones de Montréal
Le Foyer pour femmes Autochtones de Montréal offre un environnement sécuritaire aux femmes et aux enfants des Premières nations, des Inuits et des Métis. Grâce à un soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et à une approche holistique qui allie la guérison traditionnelle aux méthodes contemporaines, nous aidons les femmes et les enfants à surmonter les difficultés, à s'engager dans la voie de la guérison et à jeter les bases d'un avenir positif.
Centre d'amitié autochtone de Montréal
Depuis plus de 40 ans, le Centre d’Amitié Autochtone de Montréal Inc. (CAAM) fournit des services de qualité continue à la population autochtone urbaine de Montréal et à leurs familles, et est le seul point de service et de référence complet dans la région métropolitaine de Montréal (RMM) en ce qui concerne: santé, services sociaux, juridique, orientation / information, éducation, formation et orientation professionnelle pour ceux qui migrent vers ou à travers la ville, y compris ceux de partout au Québec, au Canada et dans les Amériques.
Femmes Autochtones du Québec
Fondée en 1974, Femmes Autochtones du Québec Inc. (FAQ) représente les femmes des Premières Nations du Québec ainsi que les femmes autochtones qui vivent en milieu urbain.